Qu'est-que l'effet bulle?
Les Sciences-pistes constituent déjà un entre soi en ceci que le profil des élèves converge en certains points, en particulier du fait de leur capital culturel. Malgré les origines sociales très variées de ses étudiants, Sciences Po s’efforce à construire un sentiment d’appartenance et à transmettre des valeurs communes au travers de son fonctionnement et de son enseignement. Par exemple, l’engagement, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie associative, a une place prépondérante dans la vie étudiante à Sciences Po Paris. Par ailleurs, l’étiquette “ grande école” consolide cet entre-soi et bien avant de rentrer dans l'institution. L’entrée à Sciences Po Paris est sélective et se fait par le biais d’un concours. De cette façon, les candidats essaient de faire correspondre leur profil aux attentes de l’école. Dès lors, ils se façonnent une identité d’élève à Sciences Po Paris. Le cas de Facebook dans le cadre de l’étude se révèle pertinent puisqu'il est un acteur clé de l’organisation d’évènements étudiants dans la vie sciences pistes. La majorité des informations importantes à Sciences Po sont relayées sur Facebook, c’est aussi une plateforme d’entraide où les élèves peuvent partager leurs expériences, leurs difficultés ou leurs inquiétudes. Nous viendrons à nous demander “ Comment l’utilisation de Facebook confronte-elle les étudiants de Sciences Po à un effet bulle”
Notre exploration prend en compte plusieurs paramètres et conjecture plusieurs hypothèses. Tout d’abord, même s’il est vrai que Facebook est le réseau social principal à Sciences Po et plus généralement, le leader sur le marché du réseau social avec plus d’un milliard de compte enregistré; le réseau social fait face à une fracture générationnelle. En effet, ce n’est pas le réseau social le plus utilisé par les sujets de notre recherche. En France par exemple, Instagram est le réseau social le plus utilisé à 84% chez les 16-25 ans. Par conséquent, notre étude observe les dynamiques sur Facebook parce qu'il est tout particulièrement utilisé à Sciences Po Paris, cependant ce n’est pas une plateforme représentative de l’utilisation des étudiants des réseaux sociaux du fait de sa désuétude.
Notre exploration prend en compte plusieurs paramètres et conjecture plusieurs hypothèses. Tout d’abord, même s’il est vrai que Facebook est le réseau social principal à Sciences Po et plus généralement, le leader sur le marché du réseau social avec plus d’un milliard de compte enregistré; le réseau social fait face à une fracture générationnelle. En effet, ce n’est pas le réseau social le plus utilisé par les sujets de notre recherche. En France par exemple, Instagram est le réseau social le plus utilisé à 84% chez les 16-25 ans. Par conséquent, notre étude observe les dynamiques sur Facebook parce qu'il est tout particulièrement utilisé à Sciences Po Paris, cependant ce n’est pas une plateforme représentative de l’utilisation des étudiants des réseaux sociaux du fait de sa désuétude.
Nous avons choisi de nous focaliser sur le campus de Paris. d’une part parce que le terrain est assez riche: le campus accueille environ 3000 étudiants dont plus d’un tiers sont des étudiants internationaux. En plus du Collège universitaire, il y a 7 écoles de Masters sur le campus. D’autre part, l’étude des campus de province demanderait de revoir l'angle de notre exploration. De chaque campus se dégage une expérience différente; la taille, la position géographique et les enseignements ont un impact considérable sur la vie étudiante. Nous avons aussi noté que les algorithmes sur les réseaux sociaux nous proposent très rarement de consulter les comptes des associations et des étudiants hors du campus de Paris. Or, c’est notre principal outil de recherche.
Nous sommes conscients que nous sommes aussi soumis à l’effet bulle de Sciences Po, ainsi les constats tirés sont à prendre avec vigilance. Une trop grande confluence entre nos hypothèses et les résultats contribuent à prouver la vigueur de l’effet bulle. De plus, il est à anticiper, dans les étudiants interrogés, une surreprésentation des élèves nous ressemblant le plus, c'est -à -dire des étudiants en deuxième année du Collège universitaire.
Il existe très peu voire aucun texte scientifique sur l’effet bulle; voilà pourquoi nous partons principalement d’un constat personnel. Comme énoncé précédemment, d’autres concepts sont solidaires à celui de l’effet bulle et ce sont ceux que nous avons choisi d’exploiter dans nos recherches.
Une fois ces variables déterminées, nous avons posé une série de postulats. L’existence d’une communauté Sciences-pistes est indéniable.
Cependant, nous ne pouvons pas arrêter notre analyse de façon superficielle.
En premier lieu, tous les étudiants ne se ressemblent pas, à l’intérieur d’une grande communauté, il y a une multitude d’entre-soi. Nous avons pris l’exemple de cinq groupes: les étudiants internationaux, les étudiants en double-diplôme, les étudiants issus de la Convention d'Éducation Prioritaire, les étudiants en situation de handicap et les étudiants en Master. Pour chacun de ces groupes, l’agencement de leur scolarité favorise un effet bulle:
- Les étudiants en double diplôme passent moins de temps dans l’enceinte du campus que le reste des monocursus, ils ont cours dans d’autres universités de la capitale. De surcroît, même au sein de ces différentes universités, ils sont exclusivement dans des classes d’élèves de Sciences Po en première année.
- Les étudiants issus de la Convention d’Education Prioritaire (CEP) bénéficient de programmes de tutorats, d’évènements et d’associations qui tendent à les mettre tous en relation.
- Les étudiants en situation de handicap, physique ou moral, ont parfois besoin d’aménagement de scolarité. La nécessité de faire progresser l'institution sur les enjeux de validité quant aux infrastructure et aux services rendus aux étudiants en situation de handicap encourage l’entraide.
- L’année en échange correspond à une année particulière pour les étudiants internationaux et les étudiants français qui partent hors les murs. La barrière de la langue et de la culture étrangère favorise le repli sur soi-même et sur les choses et les gens qu’on connaît
- Pour le cas des étudiants en Master, nous avons choisi de confronter leur effet bulle à celui des étudiants du Collège universitaire. Il était tout à fait envisageable de regarder les dynamiques de communautés au sein des différents Master mais le manque de lien entre le Master et le Collège universitaire est intéressant à étudier. En effet, les cours de langue et les associations sont les espaces où les deux sphères peuvent communiquer. On remarque une réelle scission entre les deux formations. Il est important de préciser que tous les Masters ont lieu sur le campus de Paris et qu’il y a une deuxième session d’admission en Master. Une vague de nouveaux étudiants arrive à Sciences Po en Master.
D’autre part, Sciences Po promeut la figure de l’étudiant engagé au travers du Parcours civique, de la multitude d’associations, d’initiatives étudiantes et de conférences. Tout au long de l’année, les étudiants peuvent participer à une série d'événements organisés par l’école ou par les associations. Il est possible d’en faire la publicité auprès des étudiants en donnant des tracts, cependant aujourd’hui l’utilisation des réseaux sociaux est préférée. Cet espace virtuel permet de s’informer, relayer, commenter toutes informations concernant de près ou de loin Sciences Po Paris. La vie associative et la vie politique règnent avec hégémonie sur le campus. Là encore, on peut observer la naissance de communautés associatives et la polarisation des informations politiques.
Afin de mener à bien notre enquête, nous commencerons par l’observation et l’analyse de divers groupes Facebook. Celle-ci consistera en l'analyse des comptes et groupes suivis par les étudiants, et l’envoi de questionnaires (type Google Form) à faire compléter par des scientifiques en Bachelor, Master et Doctorat. Le questionnaire a été partagé sur les réseaux sociaux et dans les associations. Il a le défaut de ne pas toucher les étudiants qui ne font pas partie de ces plateformes. Nous avons interviewé plusieurs étudiants sur la base des mêmes questions: l’effet bulle, les réseaux sociaux et Facebook. Dans un second temps, nous analyserons les statistiques d’activité, de partage et de likes de posts des groupes les plus populaires à Sciences Po.
Enfin, s’il est vrai que cet effet de communauté existe, est ce que les étudiants de Sciences Po le ressentent et le conçoivent ainsi? Nous nous sommes posés la question des liens forts créés à Sciences Po, la plupart à l’évidence homophile. Il faut aussi interroger les étudiants sur leur sentiment d’appartenance à cette communauté et à l’importance qu’ils accordent aux réseaux sociaux. Certes, qui se ressemblent s’assemblent, mais il s’avère nécessaire de ne pas ignorer que ceux avec qui nous n’avons pas de liens, du fait de nos différences, jouent aussi un rôle influent dans notre vie sociale ou professionnelle.
Avant-propos
Il est évident que les premières questions de notre questionnaire concerne l’utilisation des réseaux sociaux numériques et en particulier l’utilisation de Facebook des étudiants. Sans surprise, les réseaux sociaux sont utilisés par 94,7% des questionnés, afin, dans la majorité des cas de se divertir, de s’informer, et de communiquer avec les autres. Les étudiants de Sciences Po Paris, tout comme les jeunes de leur âge, utilisent en majorité Instagram, suivi de Whatsapp. Facebook fait figure de bon dernier. Bien que certains des répondants décrivent le réseau-social comme simple d’utilisation, l’adjectif “Dépassé” prime. 94% des étudiants qui n'utilisent pas Facebook ont tout de même un compte. Que les étudiants utilisent ou n'utilisent pas Facebook, tous sont d’accord pour dire que la vie étudiante, les groupes de promotion, les associations, se déroulent aussi sur Facebook. Son utilisation permet à certains d’être au courant des évènements, à d’autres, de se renseigner sur les cours ou sur le fonctionnement de l'administration de Sciences Po auprès d’autres étudiants.
I. Les dynamiques de l'effet bulle à Sciences Po Paris
Nous avons évoqué précédemment la diversité des étudiants à Sciences Po, et comment chacun d’entre eux pouvaient être touchés par l’effet bulle. Cependant, il semble important de préciser en quoi cet effet bulle, pourtant si commun à tous, peut revêtir différents aspects selon les caractéristiques sociologiques du sujet observé. Nous avons donc décidé de catégoriser plusieurs groupes d’étudiants type, afin d’étudier le rapport de l’effet de bulle et l’effet de groupe en fonction de critères sociologiques. Voici donc les groupes qui ont fini par émerger :
- Étudiants en CEP-
- Étudiants en double diplôme-
- Étudiants en Master -
- Étudiants en échange universitaire*
*N'ayant pas reçus de réponse au questionnaire de la part de ces étudiants, nous n’avons donc pas pu analyser l’impact existant – ou non – de l’effet bulle dans leurs interactions. Cependant, on peut tout de même en tirer quelques hypothèses, si ce n’est des constats. Tout d’abord, cette difficulté à entrer en contact montre bien qu’il existe des barrières invisibles entre ces étudiants étrangers, qui ne sont présents que pour un seul semestre, et le reste de la population étudiante de Sciences Po. En effet, la courte période de leur séjour, les différences culturelles, combinées à la mise en place de plusieurs mécanismes d’intégration tels que des associations qui leur sont spécialement dédiées (ex : Melting pote) favorisent finalement bel et bien la création et le renforcement d’un effet bulle. Nos observations nous ont donc amenés à établir les constats suivants : les étudiants en échange sont soumis à un effet de bulle, aussi bien dans la vie « réelle » que sur les réseaux sociaux, où ils ne font partie que de leurs propres groupes Facebook. Cependant, ce constat reste à relativiser, en vue de l’absence de d’éléments formels (tels que les réponses aux questionnaires) pour appuyer ces observations
Étudiants en CEP
Concernant les étudiants issus des Convention d’Éducation Prioritaire (CEP), nous avons obtenu 24 réponses au questionnaire, ce qui nous a permis de tirer des constats bien plus fiables. L’effet bulle est plus que présent chez cette catégorie d’étudiants, qui bénéficient de plusieurs mécanismes d’intégration spécifiques qui, d’une certaine manière, les distingue des autres étudiants, et tend à renforcer les liens entre eux. Si la majorité d’entre eux font bien partie de communautés sur leurs réseaux sociaux, c’est moins le cas sur Facebook, où l’effet bulle se fait beaucoup moins ressentir. L’effet de groupe se ressent donc plus dans les interactions physiques plutôt que numériques, et il tend à diminuer avec le temps, puisque plusieurs étudiants ont mentionné le fait que les amitiés tendent à s’élargir en deuxième année de Bachelor. S’ils ont donc bien tendance à faire partie d’une bulle à première vue, les étudiants en CEP tendent à s’en extraire au fil du temps, pour former un agrégat plus homogène avec le reste de la communauté étudiante au fil du temps.
Étudiants en double diplôme
Quant aux étudiants en double diplôme, nous avons reçu un nombre de réponses équivalentes au questionnaire, ce qui permet d’amputer le même degré de fiabilité en nos résultats. Mais contrairement aux étudiants issus de CEP, l’effet bulle est beaucoup plus palpable chez les étudiants en double diplôme, et notamment sur Facebook, puisque plus de la moitié d’entre eux appartiennent également à des groupes les concernant sur cette plateforme. Tout d’abord, cela peut s’expliquer par le fait que cette catégorie d’étudiants est davantage institutionnalisée que les précédents. En effet, les étudiants en double diplôme, peu importe leur cursus, bénéficient de dispositions bien particulières qui renforce un effet de groupe déjà naturel. Par l’intégration à une « triplette » en première année, constituée exclusivement d’étudiants faisant partie du même cursus, ayant le même emploi du temps, l’administration de Sciences Po favorise, de manière inconsciente ou non – le renforcement des liens qui unissent ces étudiants. On peut même noter l’existence de « microbulles » selon le cursus suivit par les étudiants en double diplôme.
Étudiants en Master
En ce qui concerne les étudiants en Master, les dynamiques de l’effet bulle sont plus difficilement observables, puisqu’il existe de nombreux facteurs qui individualisent les types de cas rencontrés. En effet, il faut distinguer les étudiants en Master ayant fait toute leur scolarité à Sciences Po ou non, et parmi ceux pour qui c’est le cas, le campus d’origine en Bachelor, qui joue également sur les perceptions. En effet, être issu d’un campus de région (de province) est un déterminant important dans l’expérience des étudiants et les rapports qu’ils entretiennent entre eux. Incontestablement, l’effet bulle ne se fait pas ressentir de la même façon selon le campus, en raison de la population estudiantine qu’on y retrouve et le nombre d’étudiants également, la taille de la promotion jouant également.Cependant, de manière générale on peut établir un constat commun concernant l’ensemble des étudiants de Master, qui est le suivant : l’effet bulle subit une transformation, puisqu’il ne se manifeste plus de la même manière en divisant les étudiants selon les catégories précédemment définies. En effet ce sont plus l’appartenance à une association ou le critère sociologique qui va être déterminant dans la création d’une bulle, mais davantage l’appartenance à l’une des 7 Écoles. Mais là encore, il existe des microbulles selon les formations suivies, chaque Master ayant ses propres spécificités. Cela se remarque sur Facebook, avec la présence de nombreux groupes pour chaque École, puis chaque Master. Cependant, la barrière de ces bulles est beaucoup plus souple que ce qu’on avait pu voir dans le cadre des étudiants en Bachelor.
II. Le Sciences-piste, un étudiant engagé
Nous avons observé l’émergence de certaines bulles au sein de Sciences Po. Il s’agit dès à présent de rendre compte des dynamiques de la vie associative et politique, qui à notre sens, fédérent les étudiants et créent une sorte d’identité du Scciences-piste, la figure de l'étudiant engagé. Comme son nom l’indique, à Sciences Po Paris la politique à une place majeure . Sur toute la population intérrogée lors de notre exploration, près de 70% des étudiants se considèrent comme personnes politiséeq. Nous reprendrons les travaux de sociologues du LISST ( Laboratoire interdisciplinaire, solidarité, territoire notamment); par le biais de l’article “ Facebook favorise-t-il la désinformation et la polarisation idéologique des opinions”. Dans ce texte, les auteurs choisissent de se recentrer sur les individus les plus engagés politiquement, à leur manière d’utiliser Facebook et de partager des informations globalement homophiles et alignées avec les positions politiques de leur parti. Ils observent les élections présidentielles françaises de 2017 et examinent les groupes et les pages Facebook affiliés des 5 partis les plus populaires : le Front National, Les Républicains, La République En Marche, le Parti Socialiste et La France Insoumise.
Cette observation permet d’introduire le concept de polarisation, car c’est un article avant tout sur la polarisation des informations et la désinformation. Au sens figuré, la polarisation est l’action de concentrer en un point (des forces, des influences...) ; en sociologie cela correspond à la division de la société en pôle opposé. Cependant, la définition la plus forte et la plus proche du concept reste la définition en psychologie sociale. « La polarisation de groupe est la tendance pour les groupes à prendre des décisions plus extrêmes que l’inclination initiale de ses membres considérés individuellement». Cette définition correspond aux mécanismes que l’on retrouve très clairement dans la polarisation des informations des communautés politiques. L'effet bulle a pour effet de piéger les individus dans le confort de leurs opinions puisqu’ils ne sont plus confrontés à des informations divergentes de leur centre d’intérêt. Étudier la polarisation des opinions auprès des élèves de Sciences Po permet de déterminer s'il n’existe pas là encore un effet de bulle à l’échelle de l’école.
La fracture entre les jeunes et Facebook se fait vivement ressentir dans le cadre du politique. En dehors de la vie étudiante, les individus n’utilisent pas, pour la majorité, la plateforme pour consommer du contenu politique; bien qu’ils suivent, sur d’autres réseaux sociaux, des créateurs de contenu politiques, des politiques, des partis politiques, des médias… Il est encore possible de témoigner d’un effet bulle des étudiants de Sciences Po Paris, vis -à-vis du politique; cependant le faire sur Facebook se révèle être non représentatif et vain
.Une maigre majorité des répondants déclare se sentir le plus proche de la branche politique de gauche (47%), suivi de près par le centre gauche (23,8%) et l'extrême gauche (16,7%). Le Sciences-piste se place donc à gauche sur l’échiquier politique. Comme dans l’article “ Facebook favorise-t-il la désinformation et la polarisation idéologique des opinions”; les étudiants ou tendance à regarder, partager, commenter du contenu de la branche politique dont ils se sentent le plus proche. Dans le cas contraire, la démarche est souvent motivée par la critique de l’oppositon. Si l’étudiant de Sciences Po est engagé politique en théorie, dans les faits le constat est différent. En effet, seul une minorité de 8,1% des répondants fait partie d’une association politique à Sciences Po. Ce qui laise à penser que les réseaux sociaux modifient quelque peu les formes d’engagement politique.
Malgré un engagement très faible dans les associations politiques, nous constatons que cette fois-ci, Le réseau social de facebook est utilisé par la moitié des répondants pour suivre les associations politiques au sein de Sciences Po, alors qu’elle ne l’était pas du tout pour dans le cas de contenus politiques extérieurs au cadre de Sciences Po. On peut donc déduire que l’utilisation de réseau social Facebook par les étudiants de Sciences Po est très largement conditionnée par la vie étudiante et les interactions sociales que celle-ci implique
Commençons par une affirmation très simple : beaucoup d'étudiants utilisent Facebook pour suivre la vie associative à Sciences Po Paris. 93,7% des répondants à notre sondage attestent que Facebook a un lien avec leur vie étudiante et 53,4% expliquent avoir téléchargé la plateforme à leur arrivée à Sciences Po. Lorsqu’on leur demande pourquoi, les trois réponses les plus fréquentes sont : “les associations”, “les événements”, “les groupes de promo”. D’ailleurs, c’est à la fois dans le Google Form et lors des entretiens que plusieurs élèves indiquent qu’on leur a annoncé dès le début que Facebook était indispensable pour suivre la vie associative, à moins d’être isolés de cette dernière. Le premier constat nous porte à penser que se créer un compte Facebook et/ou télécharger l’application est presque une nécessité lors de l’entrée à Sciences Po.
Il s’agit par la suite de différencier les diverses raisons de suivre les différents comptes d’associations de l’IEP de Paris. Nous en distinguons deux majeurs : pour gérer et encadrer l’activité des associations dont il font partie, et pour suivre les activités de celles qui les intéressent et dont ils ne sont pas membres. Ainsi, 82,2% de nos répondants affirment suivre des associations dont ils ne font pas partie et parmi les plus citées il y a : le BDE, les quatres autres associations permanentes (SPE, AS, BDA, SPK), des syndicats et d’autres plus petites associations. Le co-président du BDE nous a expliqué durant son entretien que plus de 90% des étudiants suivant la page Facebook du Bureau Des Élèves n’étaient pas “staff”. D’ailleurs, le BDE faisant partie des cinq associations permanentes du campus de Paris, l’observation du nombre, de l’âge et de l’origine des différents étudiants suivant leur page, nous a permis de déduire que beaucoup ne se désabonnent pas, même lorsqu’ils quittent Sciences Po. Que ce soit pour une année de césure ou simplement lorsqu’ils obtiennent leur diplôme. À l’interrogation à ce sujet, la responsable du pôle partenariat de SPK (Sciences Polémiques) a supposé que comme pour beaucoup, Facebook n’était pas leur réseau social principal, rester abonné à certaines pages ou rester dans certains groupes était une manière de garder un souvenir de leur expérience universitaire.
Notre observation de la composition des membres des deux grands groupes : “Interrasso”, rassemblant le plus grand nombre de membres à haute responsabilité des associations (président, secrétaire, trésorier, responsables événements et communication) et ayant pour but d’annoncer les évènements à venir de chaque association, afin que ces dernières puissent s’organiser entre elles, et “Sciences Po International Students 2022/2023”, dont le nom est explicite, nous a permi de faire trois constats. Tout d’abord, le premier groupe est essentiel pour la coordination des événements. Bien que chaque association utilise aussi d’autres plateformes pour communiquer leurs projets à venir, Interrasso est un pilier majeur de collaboration. Dates, lieux et noms de responsables y sont communiqués et chaque sciences pistes engagé dans une association en connaît l'existence. Par la suite, l’observation du groupe des étudiants internationaux nous a permis de déduire une logique que les résultats du sondage ont confirmé. Un science piste suit en moyenne une dizaine de comptes d’associations. En revanche, l’entretien avec deux élèves de deuxième années, désormais à l’aise avec le fonctionnement de l’école, nous a confirmé que le terme “suivre” était à prendre avec des pincettes, puisque cela ne garantissait pas un véritable suivi de tous les posts et annonces sur Facebook dans associations auxquelles ils étaient abonnés. En outre, 95% des répondants ont confirmé avoir le sentiment de faire partie d'une communauté d'étudiants faisant partie des mêmes cercles associatifs. Enfin, il est évident que les étudiants suivant le plus de comptes associatifs sont aussi les plus engagés et il y a une véritable dans les comptes que suivent les étudiants, en fonction des associations dont ils font partie. Par exemple, la moitié des membres de MTP (Melting Potes, association pour les étudiants internationaux) est à la fois sur le groupe des étudiants internationaux et suit Ramen-toi (association des étudiants asiatiques) et la Scala (association des étudiants italiens), toutes deux des organisations à portée internationale.
III. Le sentiment de communauté, la force des liens faibles
Après une liste de questions sur la vie associative, la vie politique et les communautés. Nous avons demandé concrétement aux étudiats s'ils se sentaient prisonniers d’une bukke à Sciences Po ou s’ils avainet le sentiment d’appartenier à une communauté fermée à Sciences Po Paris. La réponse est négative à l’unanimité ou du moins nous ne pouvons faire de ces questions une analyse binaire. Nous pouvons nous demander si le sentiment de non appartenance à une communauté fermée à Sciences Po n’est pas le signe d’un phénomène qui fait la particularité et qui confère à Sciences Po son étiquette d ‘”école élitiste “. Sciences Po Paris est renommée pour la force de son réseau, or d’après le sociologue Mark Granovetter dans sa thèse des liens forts et des liens faibles et de la force des liens faibles; les liens faibles, c’est -à- dire, les conctacts brefs ou occasionnels avec des individus que l'on connaît peu ou pas on un impact considérale sur la vie sociale et la vie professionnel; bien plus que les liens forts que l’on crée ou que l’on a comme la famille et les amis.
En ayant une multitude de communautés, qui ont des centres d’intérêt diverses et variés, Sciences Po crée aussi une multitude de liens faibles. D’autant que cette théorie est renforcée avec l’utilisation des réseaux sociaux numériques. Dans un premier temps, l’utilisation primaire des réseaux sociaux reste de communiquer avec nos proches mais elle incite aussi à communiquer avec des gens que l’on rencontre seulement dans un monde virtuel. L’utilisation de Facebook permet de créer de liens faibles avec d’autres étudiants dont le seul lien est de faire ses études au sein de Sciences Po. Cette utilisation est propice à la diversification d’opportunité professionnelle, surtout que l’école fait figure de terreau de personnnes jugées hautement qualifiées.
IV. Conclusion
Pour conclure, intéressons-nous aux limites rencontrées tout au long de notre travail. Pour commencer, l’effet bulle est un phénomène qui plus difficilement observable sur un réseau social tel que Facebook, que beaucoup d’étudiants juge “dépassé”, voire “obsolète” et par conséquent qui est largement moins utilisé que d’autres plateformes.
De plus, si l’utilisation de Facebook demeure limité dans le temps, elle l’est aussi dans ses usages qui sont moins nombreux et plus spécifiques : suivi d’actualités des principales associations, adhésion à différents groupes (recherche de stage, conseils de Master, etc) , ce qui crée d’office un espace virtuel propre aux microbulles, à l’intérieure de la bulle “Sciences Po”.
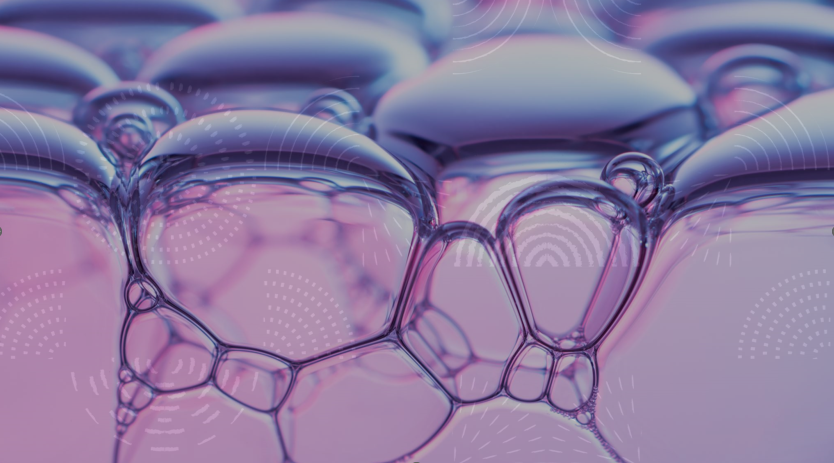
En ce qui concerne notre méthode d’enquête, le questionnaire Google Forms a en grande partie porté ses fruits, puisque nous avons obtenu des réponses intéressantes pour notre analyse et dont nous avons tiré des constats parfois marquants. Cependant, il semble important de pointer du doigt une limite, qui repose sur le fait qu’une partie des questions se basent sur des critères se rapportant à des ressentis, des impressions d’étudiants. Or, les sentiments étant propres à chacun, les conclusions sont à prendre avec des pincettes, et on ne saurait étendre nos résultats à l’ensemble de la population étudiante par exemple. Mais l’aspect objectif et factuel des autres questions nous ont néanmoins permis de confirmer certaines hypothèses et d’en réfuter d’autres.